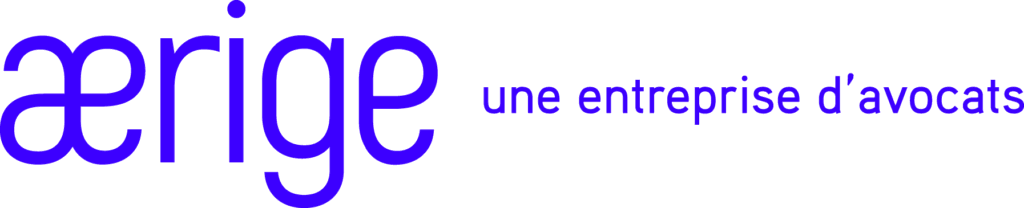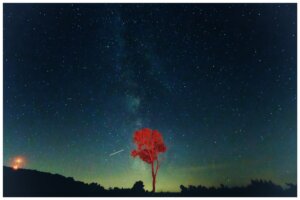L’exception confirme (souvent) la règle. Lorsque la preuve a été obtenue via des stratagèmes ou à l’insu d’une personne, elle est déloyale et donc, en théorie, irrecevable.
L’habitude n’est plus à démontrer. En 2023, 37,7%* des français ont eu recours au télétravail au moins une fois par semaine. Mais, il n’y a pas de droit au télétravail ! Il nécessite dans tous les cas une demande suivie d’un accord de la part de l’employeur.
Ça, c’était avant. En décembre 2023*, la Cour de cassation a opéré un revirement inédit. Désormais, le droit à la preuve peut justifier la production d’une preuve déloyale. Le juge doit tout de même considérer la proportionnalité de la preuve face aux droits potentiellement entravés. On parle de méthode de mise en balance.
Cette décision a été mise en pratique dès janvier 2024**. Dans le cadre d’un harcèlement moral, un salarié produit un enregistrement clandestin d’un collaborateur. Le juge se munit de sa balance : la preuve n’était pas indispensable pour appuyer la demande du salarié ; elle a donc été écartée.
Si l’évolution jurisprudentielle est certaine, la recevabilité de la preuve déloyale n’est pas automatique et demeure soumise à l’examen juge !
*Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648
**Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.474